Si on devait faire défiler le CV de Valentine Goby, auteure et romancière à la manière du palmarès d’une sportive, on tracerait les grandes lignes : 46 ans, plus d’une dizaine de romans pour les grands, une douzaine pour les jeunes, une vie, aussi, de professeure de français et de théâtre en banlieue parisienne. Mais, on n’aurait évidemment pas tout dit parce que celle qui « craint le chlore et préfère l’eau des torrents » est aussi une auteure qui aime travailler des thèmes et des histoires en profondeur. Comment, par exemple, « une femme regarde et change le monde, par amour, par envie, par orgueil, par ennui, par vengeance ». Bref, elle aime s’immerger dans divers univers comme elle l’a fait pour Murène (Éditions Actes Sud, 2019), l’histoire d'un jeune homme devenu handicapé à la suite d'un accident et dont la renaissance va épouser les débuts du handisport. Un livre né devant l’écran noctambule des épreuves de natation des Paralympiques de Rio 2016 qui lui a valu l’année dernière le « Prix Sport Scriptum » décerné par l’Union des Journalistes de Sport en France.
Commençons par « la » question de 2020 pour une auteure : avez-vous profité des deux mois du confinement pour écrire ?
Absolument pas ! J’ai besoin de mouvement et de rencontres pour écrire. Les deux mois du confinement ont été une période de grande disette en écriture. En fait, j’ai plus lu qu’écrit et surtout je me suis laissée traverser par cet immense silence de la culture, des librairies fermées, des éditeurs arrêtés. J’ai donc choisi de traverser le grand désert du confinement pour me questionner sur ma place dans le monde et dans la société. Questions loin d’être soldées (sourire)… Mais je ne fais pas partie des personnes les plus frustrées par cette période puisque mon dernier roman Murène est sorti à l’été 2019 et j’avais déjà bien assuré sa promotion dans les festivals et les librairies.
Revenons donc à « Murène », le point de départ de son écriture, ce sont les Jeux paralympiques de à Rio en 2016 ?
Je devais livrer une chronique d’actualité internationale pour France Culture et je me sentais absolument incapable de traiter des conflits en Syrie ou au Moyen-Orient. Je cherche donc une actualité périphérique et je me rends compte qu’on est en plein Jeux paralympiques de Rio, un monde auquel je ne connais absolument rien. Mais ce qui m’attire pour bâtir mes romans, c’est justement l’inconnu, l’étrangeté que je revisite par l’écriture. Bref, j’allume la télévision et je tombe sur la natation des Paralympiques de Rio et je me retrouve face à une galerie de corps très impressionnante, avec différents handicaps.

Et là, un nageur, le Chinois Zheng Tao, retient votre attention. Pourquoi lui ?
Il m’avait marqué tout simplement parce qu’il tenait une serviette dans la bouche avant le départ et je retiens vite son nom sur l’écran. Ensuite, la caméra le suit sous l’eau et filme ce corps qui ondule d’une manière merveilleuse et change mon regard en quelques secondes sur ce corps que je pensais déficient et se révèle magnifique et finalement champion paralympique. C’est ce qui me donne envie de raconter ce que peut être l’histoire d’un être qui subit la perte de ses deux bras et tente de réinventer toute sa vie à travers le handisport. Voilà comment je commence à écrire Murène, qui ne revient pas sur l’itinéraire de Zheng Tao, mais sur les balbutiements du sport paralympique dans les années cinquante.
Vous voilà donc plongée dans les archives du sport paralympique ?
Oui, c’est ce que je fais, tout en me rendant compte que je ne vais pas pouvoir faire l’impasse sur la découverte de l’univers médical, raconter le parcours de mon personnage François, son accident qui lui fait perdre ses bras et le chemin douloureux de la reconstruction d’un double amputé. En allant me documenter à l’hôpital militaire de Percy, je me rends compte que mon livre devra pour une grande partie intégrer les questionnements de la médecine, de l’appareillage des corps mutilés.
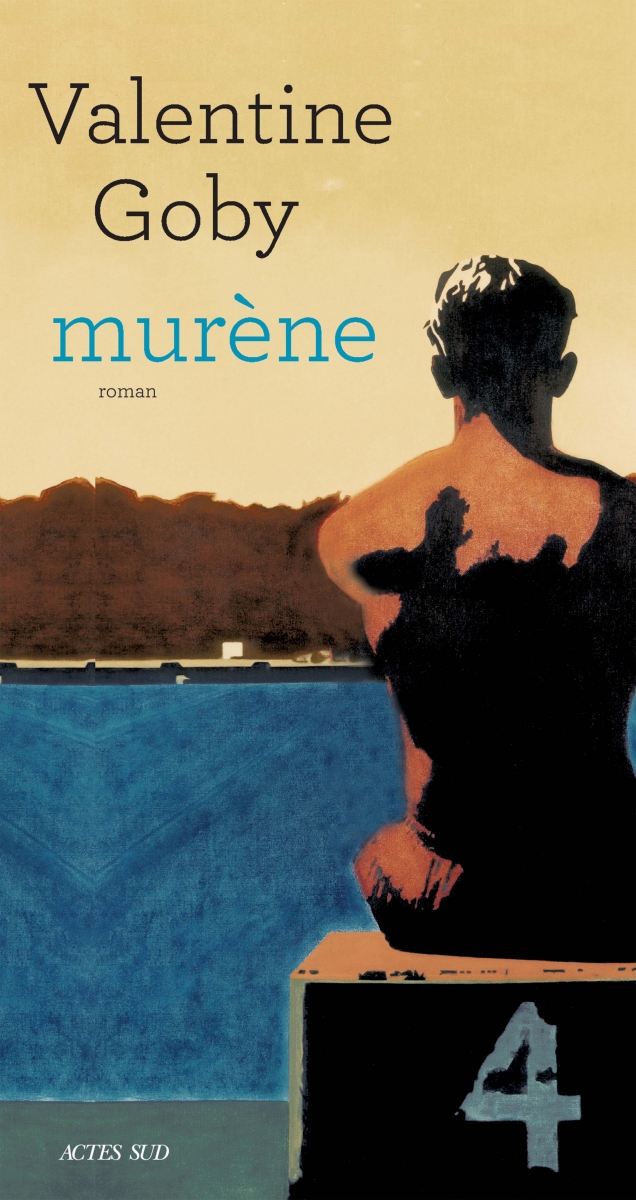
Et côté sportif, comment vous documentez-vous, vous partez à la rencontre de nageurs ?
Beaucoup de rencontres ont, là-aussi, nourri mon travail, notamment celle avec Jean-Michel Westelynck alors entraîneur national de handi-nage et évidemment beaucoup de nageurs handisport, la plupart anonymes. J’ai rencontré beaucoup d’amputés, de résistants de la Seconde Guerre mondiale, de personnes victimes de la poliomyélite aussi qui ont été au début du développement de la handi-nage. Ils m’ont raconté comment ils ont bénéficié de l’essor des piscines municipales dans les années 1950 et 1960 et du confort que leur procurait l’eau pour porter et réparer leurs corps mutilés. L’eau est un matériel très aimable et socialement les piscines municipales ont permis de toucher un maximum de monde. De l’ouvrier à l’aristocrate, il y a dans les piscines un mélange qui n’est pas forcément si évident dans tous les sports. Et ça, c’est très touchant parce qu’on se rend compte que la natation donne à voir la société dans sa globalité. Une fois dit cela, comprendre la natation était, pour moi, beaucoup plus simple que de comprendre une amputation et ses conséquences. Tout simplement parce qu’à ma petite échelle, j’avais déjà pratiqué ce sport.
Quelle était cette « petite » échelle ?
Enfant, on avait voulu faire de moi une « petite » championne de natation, mais mes parents ont refusé que je suive cette voie. J’avais entre 6 et 10 ans et j’allais nager au Cannet-Rocheville dans le sud de la France. Je me souviens encore de cette piscine qui ressemblait, pour l’enfant que j’étais, à une sorte de gigantesque pieuvre percée de hublots. L’histoire, c’est que je prenais des cours de natation dans cette piscine et mon maître-nageur de l’époque avait beaucoup insisté pour que je rejoigne les rangs du club local. Mes parents n’ont jamais voulu que je fasse de la compétition, peut-être parce qu’il n’y avait pas une grande culture de l’eau chez nous. Par la suite, j’ai pratiqué beaucoup plus de sports terrestres comme l’athlétisme, l’escrime et aujourd’hui la randonnée.
En dehors de l’exercice imposée de la chronique radio qui vous a poussée à regarder les Paralympiques de Rio, êtes-vous une consommatrice de sport télévisuel ou dans les stades ?
Oui, ça m’arrive avec un sentiment d’incompétence toujours très fort parce que je n’ai pas grandi dans cet univers-là. Mais le sport de haut niveau est une sorte de milieu exploratoire pour moi, un formidable terrain d’aventures littéraire. Dans le sport ou le handisport, comme je ne suis pas une spécialiste, c’est avant tout l’humain qui m’intéresse. L’écriture et la préparation de Murène m’ont en tout cas permis de me rendre un peu mieux compte du fait que nous sommes tous uniques. Certaines personnes le sont un peu plus que d’autres.

Si l’on reste dans la sphère de la natation, qui, justement, trouvez-vous unique ?
Les Manaudou sont uniques et doubles en même temps ! Ce seraient en tout cas des personnages de roman très plausibles. Avec, peut-être, un côté un peu plus sulfureux pour Laure Manaudou, même si je dis ça sans vraiment la connaître. Après, je trouve qu’Alain Bernard est aussi, à mes yeux, quelqu’un d’unique et de magnifique. Ce qu’il dégage est impressionnant. Le nageur paralympique Théo Curin est aussi l’exemple d’un jeune de 19 ans capable de remonter la pente de la maladie, de devenir mannequin pour Biotherm, de présenter une émission comme le Magazine de la santé. Des gens comme lui donnent une image positive de la différence.
Écrire sur l’itinéraire d’un sportif pourrait vous tenter ?
Franchement, c’est devenu tellement une telle mode d’écrire des biopics sur l’existence de sportifs exceptionnels que je ne vois vraiment pas quelle valeur ajoutée je pourrais amener. En dehors de ça, oui, je suis persuadée que les parcours de sportifs sont un vrai terrain d’écriture, surtout parce que l’individu se bat aussi contre lui-même. Le problème, si c’en est un, c’est que la compétition n’est pas forcément ce que je préfère. Moi, ce qui me séduit, c’est la manière dont les individus sont amenés à se dépasser. Dans l’histoire d’un sportif, j’aime d’abord l’histoire entre « lui et lui » ! Pour moi, et c’est peut-être un cliché, mais ce n’est pas vaincre qui compte, c’est aller au-delà de ses propres limites.
Recueilli par Frédéric Sugnot
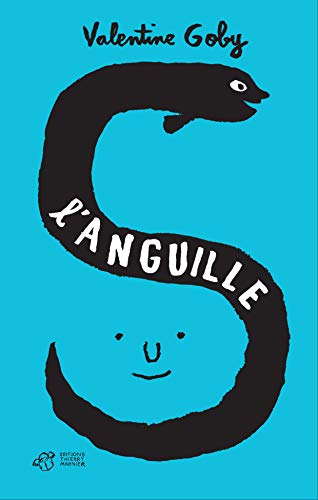
L’Anguille, un coup de jeune pour Murène
En septembre paraîtra « L’Anguille », roman jeunesse dans lequel Valentine Goby réussit le tour de force de proposer une réécriture de Murène pour les plus jeunes, sans rien perdre de la pertinence et de la puissance de ses personnages. Après François dans Murène, on suit l’histoire de Camille, collégienne en apparence normale. Pas de fauteuil, pas de béquilles... Mais Camille va bousculer son nouveau collège en retirant son manteau à « l’aide de ses dents et d’un vif mouvement du menton » pour qu’ils comprennent qu’elle n’a pas de bras. Un roman sur l’acceptation de la différence à lire dès 10 ans (Éditions Thierry Magnier, 144 pages, 11 euros).